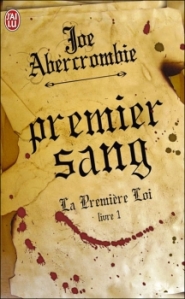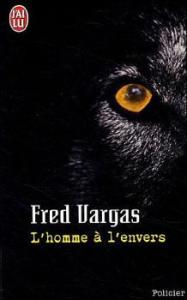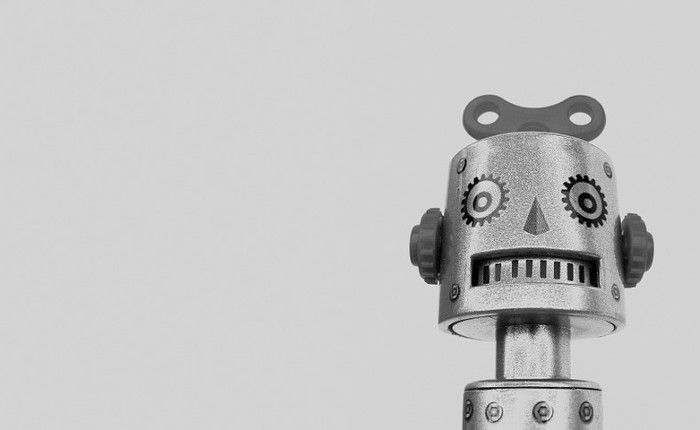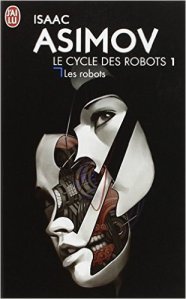L’auteur qui m’a fait renouer avec les bouquins, en me faisant dévorer en quelques mois l’essentiel du Trône de fer. J’en attendais beaucoup, d’autant qu’on me l’avait extrêmement bien vendu ; malheureusement, Wild cards est une sacrée déception. Je vais aller me lire une anthologie des X-men, pour récupérer.
Résumé :
1946, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Manhattan. La population en revient à une vie paisible, lorsque des extraterrestres font irruption sur le monde, armés d’un virus. Celui-ci est récupéré par des bandits, puis lâché sur la ville.
Les effets se font sentir rapidement : la grande majorité des victimes meurt dans d’atroces souffrances ; pour les rescapés, la vie est à peine souhaitable puisqu’ils se transforment pour devenir monstrueusement difformes.
Seule une faible minorité s’en tire, dorénavant dotée de pouvoirs spectaculaires. S’en suit alors une période d’adaptation de la société, où, cartes en mains, chacun essaie de tirer son épingle du jeu.
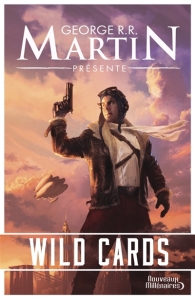
À chaud :
La lecture de ce pavé a été longue, laborieuse, et dénuée de surprise et de plaisir. Je l’ai terminé parce que je l’ai lu par petits bouts, comme on grignote un plat indigeste en espérant finir par arriver au dessert. Dessert qui, hélàs, n’est pas compris dans ce plat unique sans grande saveur.
Bon globalement, le résumé, la mise en place, l’univers, en bref, les prémisses sont plutôt encourageantes. Mais c’est tout. C’est une jolie vitrine, une jolie idée, qui n’est en fait qu’un prétexte. Un rapide tour sur Wikipedia pour voir un peu les dates d’écritures et l’histoire du projet permet de découvrir que l’idée de ce recueil est née de joueurs de jeu de rôle, et que l’invention du virus n’était en fait qu’une manière de justifier l’apparition simultanée de nombreux pouvoirs dans la société.
Parce que concrètement, le virus, on en parle au tout début pour comprendre comment il se répand, et ensuite on ne fait que le mentionner pour faire joli. Est-ce que ça a touché tous les États-Unis ? Le monde entier ? Une réduction de 90% de la population mondiale, ou de 90% de la population de Manhattan, c’est pas pareil… Et pourtant on ne répond pas à la question. Il est mentionné dans les annexes que le monde entier a été touché sur environ trois décennies, mais on s’en fout, c’est pas ça qui nous intéresse !
Non, ce qui est cool, ce sont les pouvoirs. Et puis les États-Unis. C’est vrai, le reste du monde est si insipide. Donc les pouvoirs des super-héros, aux États-Unis. Voilà, on a fait le tour ! Sans déconner, l’Histoire n’est pas impactée par ce virus : poursuite des nazis après la guerre, chasse aux sorcières sous MacCarthy (on chasse les infectés en les accusant de communisme), période hippie, enchaînement des présidents américains, tout se passe comme si le virus n’avait jamais vraiment frappé. Sauf qu’on nous parle des Jokers, les malchanceuses victimes, comme d’une nouvelle minorité qui remplace les Noirs. Voilà…
Parce que, quand même, on parle d’un virus extra-terrestre. Et un des personnages principaux et récurrents EST un extra-terrestres : mais non, en fait tout le monde s’en fiche. Il y a de la vie ailleurs, des êtres humains ailleurs, mais bon, c’est pas si important. En fait, la lecture de ce recueil est entravée par deux dynamiques qui s’annulent mutuellement : le côté spectaculaire/incroyable/catastrophique du virus, et d’un autre côté le manque flagrant de conséquences. C’est en fait un gros pétard mouillé, et à peu près aussi passionnant à découvrir qu’un trombonne qu’on retrouve sous un tas de paperasse en rangeant son bureau.
Je terminerai juste avec les Jokers (en opposition aux As qui eux ont vraiment du bol d’avoir une belle gueule et des pouvoirs super chouettes). Le roman n’en présente pas un seul. On suit exclusivement des As, et quelques humains (au moins un je crois) normaux. Les Jokers sont toujours montrés comme ayant une vie vraiment intéressante : ils se battent pour leurs droits, s’organisent en tant que minorité exclue pour survivre. Ce ne sont plus vraiment des humains, ils sont réellement différents, rarement pour le meilleur. Bref, et on a pas un seul personnage principal Joker, pas une seule nouvelle parmis les quinze qui traite spécifiquement de Jokers autrement qu’en victimes, méchants, ou figurants d’un mouvement social qui permettent de brosser une fresque socio-historique en les substituant sans vergogne aux Noirs. Le parallèle est même assez dérangeant, puisqu’en gros, toute l’Histoire est inchangée, sauf les mouvements pour les droits des Noirs qui sont juste remplacés par ceux pour les droits des Jokers. C’est vrai, ça pour le coup c’est pareil, c’est interchangeable.
Et donc ?
Et donc, par pitié, abstenez-vous. Je sais que le recueil date de 30 ans quasiment, mais en terme d’ouverture sur le monde et sur autrui, c’est moyen-âgeux. Les femmes, les Noirs, les handicapés, tout le monde prend cher dans cette apologie du super-héros américain. Aucune saveur, aucune réflexion, aucune originalité, les auteurs se sont tirés eux-même dans le pied en prenant comme idée de départ pour leur uchronie un pur prétexte qu’ils n’exploitent pas plus de 3 pages. Ce recueil est fait par des amis autour d’une table de jeu de rôle, et pour ces mêmes personnes, amis, autour d’une table de jeu de rôle. Si vous voulez de bonnes histoires de super-héros, allez plutôt vous chercher un bon comics, mais épargnez-vous Wild Cards.